|
Il existe de nombreuses techniques de mesure de la pollution atmosphérique, utilisant différents domaines de la physique, de la chimie et de la biologie. Méthodes biologiques de surveillance Ces méthodes sont basées sur les réactions des organismes vivants à la présence de polluants. On utilise généralement des végétaux plus sensibles aux variations de leur environnement. On peut mesurer l’accumulation de substances toxiques (comme le plomb) dans ces organismes, ou bien la réaction de ces végétaux lors de l’exposition à un polluant. Il est possible d’analyser la végétation déjà présente sur le site ou bien d’utiliser des plants standards génétiquement sélectionnés. On se sert par exemple de plants de tabac supersensibles à l’ozone ainsi que des plants qui y sont résistants pour surveiller la présence de ce gaz en évaluant la différence de réponse entre les deux plants. Méthodes physico-chimiques de détection Pour mesurer une concentration en gaz, on peut utiliser ses propriétés d’absorption par une solution spécifique. Parmi les méthodes utilisées, les chaînes d’absorption sont basées sur la mise en présence d’un volume connu du gaz à étudier et d’un réactif au gaz que l’on cherche à détecter. Le degré de réaction du réactif indique ainsi la concentration de ce gaz. Par exemple, dans le cas du SO2, on utilise une solution aqueuse de Tetrachloromercure de Sodium qui sert de réactif. La solution se colore en présence d’indicateurs colorés. On peut ainsi déduire la concentration de SO2 en effectuant une analyse spectrométrique à 560 nm. Ce procédé est également applicable (avec des réactifs adaptés) à d’autres gaz, comme le Cl2, le H2S ou le NH3 mais ne convient pas à la détection du CO. Une autre méthode est celle des tubes à diffusion : on déduit du taux de progression d’un gaz dans un liquide absorbant suivant les propriétés de diffusion. On effectue une analyse par spectrométrie que l’on relie au gradient de la concentration (loi de Fick). Cette technique est couramment utilisée pour la détection du NO2 (on se sert alors de Triethanolamine), mais elle est imprécise. De plus, ces deus méthodes s’appliquent difficilement à une surveillance en temps réel de la pollution atmosphérique étant donné la durée des analyses nécessaires. Il existe également des techniques permettant l’analyse d’un échantillon d’air. La chromatographie en phase gazeuse consiste à injecter un volume réduit d’air à analyser dans un gaz à valeur inerte (azote, hélium, etc…) et à séparer les gaz en trace sur une colonne de chromatographie sèche ou imprégnée, remplie ou capillaire. En sortie, les constituants sont détectés au moyen de détecteurs ultra-sensibles. Pour plus de sensibilité, on a recours à des méthodes de préconcentration cryogénique permettant d’éviter de retenir l’oxygène et ainsi limiter le phénomène de rétention d’eau. Cette technique est utilisée pour le dosage des hydrocarbures. La chimiluminescence est basée sur l’utilisation d’une réaction chimique entre le gaz à analyser et un autre composé, conduisant à la formation d’une espèce excitée qui retourne à l’état fondamental en émettant des photons. Cette méthode est principalement appliquée aux NOx. Par exemple, la réaction entre le NO2 et l’O3 donne du NO2 dans un état excité, la désexcitation se fait par émission dans le domaine du visible. |
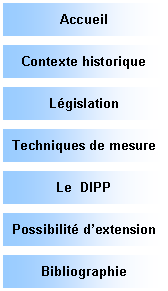
Techniques de mesure
|